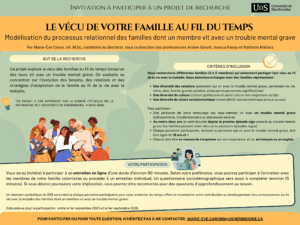Récemment, je travaillais avec différentes personnes en soins infirmiers. Je m’interrogeais sur quelles étaient les notions primordiales à transmettre aux nouvelles infirmières en santé mentale et psychiatrie. J’écoutais les échanges et je ne pouvais pas comprendre qu’en 2024, on parle encore du schizophrène du TPL ou de la tentative de suicide en faisant référence à une personne qui présente ou vit avec un trouble de personnalité limite ou qui a fait une tentative de suicide … Comment est-il possible que, malgré les avancées en matière de compréhension et de sensibilisation, on continue de résumer une personne à une maladie ?
C’est là que l’idée a germé. Hourra! J’avais en tête le premier sujet de mon billet pour le blogue du site ARRIVE. Il traitera de la communication sécuritaire, bienveillante et humaine.
On présente ou on vit avec une maladie…. Nous ne sommes pas la maladie
Il est crucial de comprendre que les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent soit renforcer les stéréotypes et la stigmatisation, soit promouvoir la dignité et le respect.
En choisissant nos mots avec soin, nous pouvons créer un environnement où les personnes se sentent comprises et soutenues, plutôt que jugées et réduites à leur diagnostic. Par ailleurs, cela contribue à enrayer l’auto-stigmatisation. Ce type de stigmatisation qui se produit par les patients eux-mêmes après avoir intériorisé les messages négatifs au sujet de leur maladie et, donc en viennent à les appliquer à eux-mêmes (Santé Canada, 2022). Oui, certain patient avant de nous dire leur prénom, nous parle de leur maladie. C’est ce qu’ils sont aux yeux des autres. Ils ont bien appris!
Pour changer cette perspective, il est essentiel de former les nouvelles infirmières à utiliser un langage qui place la personne au premier plan, un langage qui reconnaît leur humanité et leur expérience unique, sans les enfermer dans des étiquettes réductrices.
Les mots pour réduire la stigmatisation
En fait, j’ai toujours trouvé que les mots ont de l’importance pour enrayer la stigmatisation en santé mentale et en psychiatrie. Heureusement, j’ai l’impression que les expressions » fou ou folle » sont de moins en moins utilisées pour parler d’une personne vivant avec un trouble mental.
Peut-être que j’ai des lunettes roses?
Toutefois, ces personnes sont encore trop souvent désignées par leur maladie. Dans une publication de l’agence de santé publique du Canada (2018), un livret intitulé: Choisir les bons mots: communication sécuritaire pour la prévention du suicide a été élaboré pour faciliter un langage sécuritaire.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’un langage sécuritaire favorise un environnement sans stigmatisation dans lequel nous pouvons parler, entre autres, du suicide et de sa prévention ainsi que des troubles mentaux. En étant sécuritaires dans nos conversations, les chances sont plus grandes pour que les gens offrent ou demandent de l’aide. Il est primordial de placer la personne au premier plan.
Conseils pour placer la personne au premier plan
Voici quelques conseils pour intégrer la communication humaine et bienveillante :
- On évite les étiquettes ou les sigles le plus possible en s’adressant ou pour parler d’une personne.
Un exemple: une personne vivant avec un trouble anxieux ou avec une dépression est sans étiquettes ou sigles.
- On utilise des mots et phrases neutres et inclusifs pour respecter les personnes et leurs expériences.
Un exemple de placer la personne au premier plan lors d’un décès par suicide : la personne endeuillée par suicide, les personnes touchées ou affectées par le suicide ou encore une personne qui a une expérience vécue lié au suicide.
- Plus précisément pour le suicide, on utilise un langage prudent et factuel.
Exemple: Mourir par suicide, décédé par suicide, tentative de suicide, tenter de se suicider, etc.
Voici également des exemples de langage problématique à éviter :
- Commettre un suicide, a commis un suicide, suicide réussi, suicide complété, suicide raté, tentative échouée, tentative infructueuse, suicide inachevé, etc.
Le terme « commettre » est stigmatisant et a une connotation négative comme si on parle d’un acte criminel. Or, le suicide a été décriminalisé en 1972.
On peut utiliser l’expression » se donner la mort » plutôt que » commettre un suicide ».
L’impact du langage sécuritaire et bienveillant
En utilisant, un langage sécuritaire, on évite les mots qui décrivent le suicide de manière positive ou négative. On aborde également, dans ce livret, l’importance des images. Elles doivent être cohérentes au langage sécuritaire. Ceci est un avant-goût de ce que vous pouvez trouver dans ce livret. Je vous invite à en prendre connaissance.
Pour ma part, je vais continuer à transmettre la bonne nouvelle afin d’abolir la stigmatisation. Ainsi toutes les personnes qui le désirent pourront avoir de l’aide et des soins en toute humanité. Or, pour atteindre cet objectif, un changement de culture passe indéniablement par l’enseignement aux infirmières expérimentées et les novices ainsi que dans la population en générale.
Bonne lecture!
Nathalie Maltais, inf. Ph.D, professeure UQAR avec la collaboration de Rebecca Savard, inf. étudiante à la maitrise à UQAR