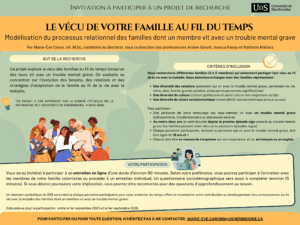Dans le cadre de la 35e Semaine de prévention du suicide, qui se déroulait sous le thème Mieux vaut prévenir que mourir (Association québécoise de prévention du suicide, 2025), un article informatif portant sur le phénomène de la recherche d’aide chez les hommes a été publié afin de soutenir une meilleure compréhension des réalités inhérentes à la condition masculine. Il s’agit d’un préambule intéressant à la lecture de ce deuxième billet portant sur la santé mentale des étudiants-athlètes et les multiples enjeux liés à la recherche d’aide.

En plus d’être confrontés aux obstacles spécifiques à la population masculine, les athlètes présentent des difficultés additionnelles propres au contexte environnemental dans lequel ils évoluent. Ces réalités fondamentales à la compréhension du phénomène de recherche d’aide chez les athlètes représentent donc un croisement singulier, entre stigmatisation et identité de l’athlète. Ce qui rend sa compréhension complexe, alors que le phénomène de stigmatisation est intrinsèquement lié à l’identité athlétique et à la culture du sport. Certains aspects associés au patriarcat, étant néfastes à la santé des étudiants-athlètes (Plank, 2021), notamment :
- le virilisme, qui renforce ou accrédite l’idée selon laquelle, l’homme s’avère supérieur à la femme. Cette idéologie de la virilité valorise les aspects physiques et la force, centraux à cette perception de supériorité (Baillette et al., 1999).
- le dolorisme, un terme dérivé et apparenté au concept d’autodestruction influence l’athlète à apprécier, incorporer et normaliser la douleur (Quelain, 2021).
- le capacitisme, fait référence aux attitudes, croyances et structures sociétales selon lesquelles un individu en situation de handicap serait moins digne de respect, moins apte à contribuer à la vie sociétale et aurait donc, une importance intrinsèquement moindre. Il s’agit d’un système de croyances pouvant s’apparenter au sexisme, au racisme et à l’âgisme (Commission ontarienne des droits de la personne, 2016).
Et ce, de façon cohérente avec les résultats de récentes études qui soutiennent que la recherche d’aide serait plus faible chez les athlètes que dans la population en général. Et encore davantage chez ceux membres d’équipes sportives (Cosh et al., 2023).
Croisement entre stigmatisation et identité athlétique : une recherche d’aide complexifiée
De façon générale, cette réalité pourrait être attribuée à des attitudes défavorables à l’égard de la recherche d’aide. Mais également à d’autres facteurs tels qu’un niveau plus faible de connaissances et de sensibilisation en matière de santé mentale, une tendance à nier les symptômes liés aux problématiques de santé mentale et une réticence à divulguer leur état. L’environnement sportif étant particulièrement propice à l’acceptabilité de certaines normes typiquement masculines, encourageant l’adoption de comportements à risques et/ou de violence. Allant jusqu’à glorifier la résistance à la douleur, par exemple, chez les athlètes qui maintiennent des activités sportives en contexte de blessure (Ramaeker & Petrie, 2019). Des craintes relatives à la perception et aux réactions des pairs représenteraient aussi des éléments clés à la compréhension du processus de recherche d’aide (Cosh et al., 2023). Des enjeux importants à l’égard de la confidentialité en milieux sportifs, des inquiétudes liées à une possible désélection au sein d’équipes sportives, à la perte de temps de jeu et/ou à l’éligibilité à certaines bourses seraient également des barrières importantes. Une situation des plus préoccupante, sachant que ces craintes s’avèrent malheureusement justifiées puisque de récentes recherches soutiennent que cette stigmatisation influence effectivement la sélection des athlètes ainsi que leur rémunération (Cosh et al., 2023).
Par ailleurs, certains événements susceptibles de survenir au cours d’une carrière sportive s’avèrent être des moments critiques et propices à l’apparition, notamment, d’un risque suicidaire chez les athlètes. Par exemple, au moment de la retraite de la vie sportive ou en contexte de blessure. Plus spécifiquement, si ces réalités sont vécues simultanément, par exemple lorsque la retraite se voit être imposée par une blessure et/ou que les conséquences physiques et psychologiques de celle-ci persistent après la fin de la carrière sportive de l’athlète. Comme c’est le cas chez les athlètes ayant subi d’importantes et/ou de nombreuses commotions cérébrales. Affectant ainsi l’image corporelle, l’estime personnelle et la santé mentale du jeune adulte (Hamstra-Wright et al., 2024). Les athlètes qui présentent un état dépressif peuvent aussi ressentir un sentiment de déconnexion à l’égard de leurs coéquipiers, devant s’adapter à des changements importants liés aux relations qu’ils entretiennent et à leur identité (Hamstra-Wright et al., 2024). Il est donc essentiel de les encourager à discuter des émotions, des inquiétudes ainsi que des problématiques d’anxiété et/ou de dépression qu’ils peuvent vivent (Souter et al., 2018).
Finalement, la compréhension du phénomène de recherche d’aide chez les étudiants-athlètes s’avère essentielle à l’optimisation des interventions en matière de santé mentale auprès de cette population. L’influence d’une masculinité particulièrement présente dans certains environnements sportifs en est un aspect clé. Ces athlètes étant souvent plus enclins à se conformer aux normes de masculinité traditionnelles d’indépendance, de stoïcisme et de contrôle. Le processus de recherche d’aide apparaît alors, pour l’athlète, être une reconnaissance des difficultés vécues et de son incapacité à les gérer de manière autonome. S’exposant ainsi à une dévalorisation personnelle et sociale. Cette situation étant souvent associée à des comportements de faiblesse ou de féminité, entraînant alors, ces jeunes athlètes, au cœur d’une lutte psychologique. Ceux-ci préférant souvent l’inaction et la préservation de leur identité masculine, pouvant engendrer des conséquences potentiellement négatives et une persistance de la détresse psychologique vécue. Les enjeux associés à la recherche d’aide chez cette population s’avèrent donc variés et complexes (Ramaeker & Petrie, 2019).
Un cadre d’intervention proposant à la fois des interventions préventives et un dépistage précoce des athlètes à risque apparaît favorable à une meilleure santé mentale et à la recherche d’aide des athlètes. En ce sens, l’éducation par le biais d’un programme de littératie en santé mentale abordant des thématiques liées aux services disponibles, à la sensibilisation, à la normalisation et à la déstigmatisation, ainsi qu’à la promotion d’identités alternatives à l’identité athlétique exclusive présente un potentiel intéressant pour une santé mentale durable au sein de cette population. L’implication des organisations sportives s’avère cependant être un prérequis essentiel à la mise en place de ces activités éducatives.
Claudia-Ève Therriault B.Sc.Inf. – Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières
Collaboration : Nathalie Maltais inf. Ph.D
Références
Association québécoise de prévention du suicide. (2025). Mieux vaut prévenir que mourir – 35e Semaine de prévention du suicide https://aqps.info/semaine-nationale-de-prevention-du-suicide/
Baillette, F., Liotard, P., & Louis, M.-V. (1999). Sport & virilisme. Quasimodo & fils.
Commission ontarienne des droits de la personne. (2016). Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap.
Cosh, S., McNeil, D., Jeffreys, A., Clark, L., & Tully, P. (2023). Athlete mental health help-seeking: A Systematic review and meta-analysis of rates, barriers and facilitators. Psychology of Sport and Exercise, 102586.
Hamstra-Wright, K. L., Coumbe-Lilley, J. E., & Bustamante, E. E. (2024). Preventing suicide and promoting mental health among student-athletes from diverse backgrounds. Journal of sport rehabilitation, 1, 1-6.
Plank, L. (2021). Pour l’amour des hommes : dialogue pour une masculinité positive. Québec Amérique.
Quelain, G. (2021). L’espace sportif français face aux violences sexuelles – Pour une organisation spatiale plus protectrice des athlètes : reconnaissance des violences et autre modèle de gouvernance. Dans Institut de Géographie (Éd.), Mémoire de Master 2 en Géographie & Aménagement.
Ramaeker, J., & Petrie, T. A. (2019). “Man up!”: Exploring intersections of sport participation, masculinity, psychological distress, and help-seeking attitudes and intentions. Psychology of Men & Masculinities, 20(4), 515.
Souter, G., Lewis, R., & Serrant, L. (2018). Men, mental health and elite sport: A narrative review. Sports medicine-open, 4(1), 57.